Selin Yenel est un diplomate de carrière. Il est actuellement ambassadeur de la Turquie auprès de l’UE, mais a également représenté Ankara en Afghanistan, à l’ONU et en Autriche. Il a aussi fait partie du ministère des Affaires européennes.
Le plan d’action commun UE-Turquie vient d’être activé, et l’UE a approuvé un fonds de 3 milliards d’euros pour aider Ankara à gérer les réfugiés et les immigrants, en échange d’une diminution du nombre d’arrivées en Europe. Est-ce suffisant pour résoudre la crise, alors que des dizaines de milliers de personnes fuient l’assaut russo-syrien contre la ville d’Alep, aux mains des rebelles ?
Premièrement, l’argent ne résoudra pas cette crise. La seule façon de la résoudre est de trouver une solution à la guerre civile syrienne, qui est en réalité devenue une guerre civile mondiale.
Plus de 70 000 personnes fuient l’assaut sur Alep. L’argent que nous a promis l’UE sera utilisé pour offrir une meilleure vie aux Syriens. Nous avons déjà dépensé 9 milliards d’euros juste pour les camps de réfugiés.
Cet argent frais nous permettra d’offrir des soins de santé, une éducation et une amélioration des camps. Il n’est pas encore arrivé, mais nous dépensons toujours. Nous espérons que cela nous aidera à gérer la prise en charge des Syriens, mais cela ne résoudra pas la crise.
La Turquie a promis d’aider les réfugiés, mais n’a pas ouvert ses frontières. Les agences d’aide humanitaire estiment que les réfugiés qui attendent de l’aide sont dans une situation désespérée. Federica Mogherini a encouragé Ankara à laisser entrer ces réfugiés sur son territoire. Que faudra-t-il faire pour qu’Ankara entende ces demandes ? Le président, Recep Tayyip Erdoğan, a rencontré la chancelière allemande, Angela Merkel, le 8 février. Que comptait-il lui demander ?
Nos frontières ont été ouvertes pendant cinq ans. Ces derniers mois, la situation est devenue si incontrôlable que nous avons dû réinstaurer une politique de visa pour les Syriens. Les gens qui fuient Alep sont près de nos frontières et sont plus ou moins en sécurité, mais nous devons vérifier qui ils sont.
Nous avons eu des incidents avec des membres de Daech et d’autres extrémistes, donc nous devons vérifier qui nous laissons entrer. Je ne pense pas que l’UE soit bien placée pour nous dire d’ouvrir nos frontières quand elle ferme les siennes. Je trouve ça assez ironique. Au final, nous aidons ces réfugiés et continuerons à le faire. Cela n’a rien à voir avec la visite d’Angela Merkel.
Qu’attendez-vous de la visite d’Angela Merkel ?
Je pense que pour l’UE ce sont les chiffres qui sont importants. Les États membres veulent que les chiffres diminuent, l’UE veut montrer à ses citoyens que l’accord passé avec la Turquie réduira le nombre de réfugiés. Nous avons introduit certaines mesures, et l’accord fonctionne.
Nous avons par exemple réintroduit la règle des visas pour les Syriens, modifier notre droit du travail pour leur permettre de trouver un emploi, introduit davantage de mesures de sécurité et lancé une meilleure coopération avec la Bulgarie et la Grèce. Ces changements prennent cependant un peu de temps.
Les Européens paniquent, ils ont besoin de notre aide. Nous avons aidé les Syriens, à présent nous devons aider les Européens.
Une grande partie de l’argent doit améliorer l’accès des réfugiés aux soins et à l’éducation, mais aussi au marché du travail. Y a-t-il assez de travail pour tous ces réfugiés, étant donné le taux de chômage élevé en Turquie ?
Nous avons en effet adopté une loi qui les autorise à travailler légalement. Nous avons accueilli 700 000 enfants qui doivent aller à l’école. Actuellement, nous ne pouvons offrir une éducation qu’à 250 000 d’entre eux, mais espérons atteindre 450 000 le plus rapidement possible.
Pour ce faire, nous aurons besoin de 25 000 enseignants, qui pourront être Syriens, puisqu’ils peuvent à présent travailler légalement en Turquie. Une partie du secteur de l’emploi s’ouvrira donc plus aux Syriens qu’aux Turcs.
L’argent européen sera alloué pour financer des projets. Pouvez-vous déjà nous donner des exemples concrets ?
Deux projets me viennent à l’esprit. Le premier est une amélioration des camps sous tentes et des camps de conteneurs. Nous avons longtemps bénéficié de l’aide du Programme alimentaire mondial de l’ONU, mais il est à court d’argent.
Avec l’argent de l’UE, nous espérons aussi donner à chaque Syrien une carte qui leur permettra d’acheter de la nourriture. Ce sont les deux projets auxquels je pense, mais les ONG en ont également beaucoup.
L’un des critères de l’octroi de fonds est que ceux-ci aillent directement aux Syriens, sans passer par les mains de la Turquie…
Il existe des garanties pour assurer que l’argent sera distribué via les services de la Commission, qui surveilleront sa destination. C’est un système de surveillance commun et l’argent ne passera pas par nos coffres et notre budget.
L’accord prévoit aussi un meilleur contrôle aux frontières turques. Comment vous préparez-vous à mettre ça en place ?
Nous avons amélioré notre coopération avec la Grèce et ses gardes-côtes. Nous avons aussi acheté plus de bateaux. L’objectif principal des services de garde-côte partout dans le monde n’est pas d’empêcher les gens d’entrer, mais de les protéger. Ce n’est cependant pas ce qu’ils ont fait ni ce qu’on a attendu d’eux, dernièrement.
Nous devons tout d’abord mieux gérer les frontières maritimes, grâce aux bateaux. Du côté terrestre, nous devons empêcher les gens de prendre la mer sur des embarcations inadaptées.
Nous arrêtons donc de plus en plus de passeurs, mais ils trouvent toujours de nouvelles façons d’arriver à leurs fins. Nous devons donc être plus malins qu’eux, c’est pourquoi notre collaboration avec la Grèce et la Bulgarie, ainsi qu’avec Frontex, est si importante.
Laissez-moi revenir aux conséquences de cette crise sur les relations UE-Turquie. Après une longue période de silence et d’indifférence, pensez-vous que les relations de l’UE avec la Turquie sont entrées dans une nouvelle phase ?
Oui, à cause de la crise de la migration, mais c’est devenu une bonne chose. Cette crise, et la menace que représente la Russie, nous ont rapprochés. Nous avons utilisé cela pour redynamiser notre relation.
Nous sommes en train de normaliser nos relations, de redevenir un candidat normal à l’adhésion à l’UE. La crise des réfugiés a mis en évidence que l’UE et la Turquie avaient besoin l’une de l’autre.
Désormais, nous dialoguons mieux, notamment au sujet de l’énergie, pour lequel le commissaire Cañete s’est rendu en Turquie, et en matière de politique. En avril, cinq commissaires se rendront à Ankara pour parler économie. Cela montre qu’il y a un intérêt grandissant des deux côtés.
La libéralisation du régime des visas pourrait avoir lieu en octobre 2016, mais cette question risque de déplaire à l’opinion publique européenne. Le diable est dans le détail. Comment allez-vous pouvoir à la fois gérer les sujets épineux, restaurer la confiance mutuelle et accélérer les choses ?
Tout d’abord nous devons mettre en place une feuille de route pour la question des visas. Notre préoccupation majeure est l’accord de réadmission. Nous avons décidé d’avancer d’un an l’accord de mise en œuvre avec les tierces parties.
Il sera fonctionnel en juin de cette année. De juin à septembre, nous remplirons les autres conditions, après quoi la Commission fera un rapport sur nos progrès. Ce sera un moment crucial pour nous. Si la Commission est satisfaite, elle formulera une recommandation auprès des États membres pour que nous obtenions la libéralisation des visas.
Les problèmes politiques qui ont freiné les négociations jusqu’à maintenant doivent être réglés. La question chypriote, par exemple, est un prérequis fondamental pour la mise en place d’un nouvel équilibre dans cette direction. À ce sujet, voyons-nous la lumière au bout du tunnel ?
Nous devons résoudre le problème maintenant. Nous le pouvons, car nous collaborons de manière efficace avec nos collègues chypriotes grecs et chypriotes turcs. Il y a encore des difficultés, des obstacles, mais il y a de la volonté des deux côtés. Nous espérons y arriver. Si c’est le cas, la relation UE-Turquie sera florissante, car nous pourrons ouvrir de nouveaux chapitres. Si ce n’est pas le cas, le cadre que nous avons établi sera mis sous tension. Nous pourrions obtenir les visas, mais pas grand-chose d’autre.
Quelle est la solution ?
La solution c’est de résoudre la question chypriote. Les deux parties dialoguent depuis tant d’années, qu’elles savent sur quoi elles doivent travailler.
Beaucoup de questions doivent être résolues, mais ce qui a changé, c’est que désormais, il y a de la volonté. Nous espérons trouver une solution durant la première moitié de l’année. Les deux parties le souhaitent, la Grèce aussi, la Turquie en a besoin, l’UE a besoin d’une success-story. Et l’ONU, bien sûr, veut aussi qu’une solution soit trouvée.
Après toutes ces années de va-et-vient, nous devrions savoir où se trouve le juste milieu...
Ils s’en approchent. Je suis assez optimiste à ce sujet, j’ai consulté les textes de négociations, ils vont dans la bonne direction. C’est faisable.
D’ici à juin ?
Oui, nous l’espérons.
Où situez-vous la Turquie du point de vue géopolitique ?
Par le passé, nous avons beaucoup parlé d’une zone de sécurité, de la manière de gérer la crise, mais personne ne nous a écoutés. Maintenant, l’idée refait surface, mais il est plus difficile de la mettre en place à cause de l’implication russe.
Notre relation avec Moscou s’est complètement dégradée depuis le crash de l’avion et après. Nous avons essayé de calmer les tensions, mais ça n’intéresse pas les Russes. Ils ne veulent pas discuter du problème ou le résoudre. Ils ne font que l’empirer.
Ils en profitent pour s’impliquer davantage et être plus agressifs en Syrie. Moscou ne bombarde pas Daech, mais l’opposition. Ils veulent pousser l’Occident à choisir entre le régime actuel et Daech. La guerre civile a pris un tournant international.
La reprise des relations Turquie-USA et le rapprochement récent avec l’UE sont-ils un nouvel espoir pour la lutte contre le terrorisme et Daech ? Pouvons-nous croire en une solution diplomatique ?
Tout le monde souhaite une solution diplomatique, mais ça n’arrivera que si tout le monde s’accorde sur ce qu’il se passe sur le terrain. Aujourd’hui, il y a encore de l’activité, des bombardements, et des meurtres. Le terrain n’est pas encore assez fertile pour un processus diplomatique et personne n’est d’accord sur l’identité de l’opposition.
Washington et Ankara, par exemple, voient différemment le rôle du PYD (Kurdes syriens), donc leur politique différent aussi. Nos alliés ne sont pas d’accord sur l’opposition syrienne. Si la situation sur le terrain ne change pas, il n’y aura pas de solution.
Actuellement, les Russes et le régime ont l’avantage. Alep tombera et un million de personnes supplémentaires seront déplacées. Qu’allons-nous faire alors ? Nous craignons cela depuis des années.
Tags:






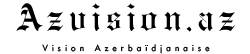

















-1732280990-1732302011.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)






















