L’Union Soviétique n’existait plus et des conflits ethniques, territoriaux ou religieux éclataient les uns après les autres sur les décombres du défunt empire. Le Karabakh était l’un de ces théâtres de guerre sanglants, peut-être même le plus important, et nous attendions l’autorisation de nous rendre sur le terrain des combats. Le gouvernement craignait pour notre sécurité et cherchait à nous trouver un moyen de transport acceptable pour faire ce périlleux voyage. L’année précédente, une journaliste azérie avait été criblée de balles dans un guetapens tendu par les milices arméniennes sur la route. La longue attente m’a permis d’interviewer des politiciens de tous bords, mais aussi d’explorer tous les recoins de Bakou, et même d’embarquer dans un hé- lico pour partir avec les ouvriers du pétrole vers Neft Dashlari, une ville construite sur un ilôt artificiel servant de plate-forme offshore. A la fin, il ne me restait plus rien d’autre à faire que d’aller visiter le musée du tapis, un luxe inimaginable en temps de guerre! l’Azerbaïdjan est l’un des berceaux de cet art répandu dans toute la région, et moi, j’en avais déjà la passion et une certaine connaissance.

Une jeune femme travaillant dans le musée s’est proposée pour me guider à travers les immenses salles, en s’arrêtant devant chaque tapis pour me donner des explications sur les couleurs et les motifs. Très vite, la courte visite s’est transformée en un voyage inattendu au Karabakh car ma jeune accompagnatrice était originaire de là-bas. Sa famille s’était réfugiée à Bakou, fuyant les massacres, comme ces milliers de personnes chassées de leurs terres par les forces arméniennes. Elle s’arrêtait longuement devant les motifs de fleurs ou d’oiseaux pour évoquer ces moments heureux des repas pris dans le jardin de la maison familiale, au milieu des rosiers. Devant les motifs de chevaux, elle se souvenait de l’insouciance de son enfance lorsqu’elle se baladait avec son frère sur le dos de ces magnifiques coursiers qui galopaient «plus vite que le vent».
Je ne voyais plus les tapis, mon regard les traversait en écoutant les souvenirs encore tout chauds de ma jeune guide: je me promenais avec elle dans les roseraies du Karabakh, on me conviait dans ses maisons, à ses tables garnies de fruits, je m’envolais sur le dos de ses Pégases.

Huit ans plus tard j’étais dans une autre région à feu et à sang, le Caucase du Nord cette fois-ci. Impossible d’entrer en Tchétchénie, interdite aux journalistes. On m’a alors parlé d’un passeur à Nalchik, en KabardinoBalkarie. Un éleveur de chevaux. En attendant d’être conduite vers la zone du conflit, je me suis intéressée à son cheptel, constitué d’une race locale en voie d’extinction. Dans une région où même les êtres humains luttaient pour leur survie, les efforts de cet homme pour sauver les chevaux étaient touchants. Et très vite je me suis trouvée embarquée dans cette aventure équestre, en faisant d’abord un film documentaire sur ces chevaux (les Chimères du Caucase), puis en écrivant des articles pour les faire connaître au monde, et finalement en organisant des structures d’accueil en France pour loger une équipe de 12 personnes et de 8 chevaux kabardines pendant 3 mois.
Au milieu de leur séjour en Normandie, je les ai accompagnés jusqu’à Jerez de la Frontera au sud de l’Espagne, qui organisait, en cette année 2002, les Jeux Équestres Mondiaux. L’équipe était d’ailleurs surtout venue du Caucase pour assister à ces jeux, une sorte d’Olympiades pour les quadrupèdes et leurs cavaliers, se déroulant dans un pays différent tous les quatre ans. Au passage, nous nous sommes arrêtés aussi pour participer aux «Deux Jours de Montcuq», une compétition d’endurance prestigieuse sur 200 km.

Avant même d’arriver sur place, notre réputation nous précédait, et éveillait déjà la curiosité. Avec le film et les articles, j’avais réussi à tisser tout un réseau de passionnés.autour des Kabardines. Partout où on allait,on nous attendait et on nous aidait avec enthousiasme. En Normandie, toute l’équipe et les chevaux étaient accueillis gracieusement, pendant 3 mois, par un fermier local; à Montcuq nous étions logés pendant un mois au château de Dominique de Gaudusson, le marquis lui-même étant passionné de chevaux et bien équipé en ce qu’il fallait de pâturages et d’écuries. A Jerez, le propriétaire de l’une des plus prestigieuses «bodegas», caves à vin, s’est proposé d’héberger nos chevaux dans ses écuries. Non seulement nous avions droit à nous enivrer du célèbre breuvage liquoreux vieillissant dans ses fûts de chêne, mais aussi nous avions à notre disposition les installations et les parcours d’entraînement réservés aux précieux chevaux andalous de notre hôte.

Nous étions devenus les chouchous de la presse locale et internationale non pas par les résultats extraordinaires qu’auraient enregistrés nos chevaux, mais à cause de l’étonnement créé par notre manque de moyens, par notre amateurisme et par notre naïveté. Malgré les conditions folkloriques dans lesquelles nous nous trouvions, qui faisaient déjà rire tout le monde avec notre drôle de camion bricolé dans une arrière-cour de Nalchik, nous avions eu l’audace de participer à cette rencontre mondiale hautement technique où les princes arabes rivalisaient avec les grandes équipes américaines, australiennes, françaises ou allemandes, transportant leurs chevaux dans des véhicules spéciaux rutilants, les cajolant avec des soins sophistiqués et les nourrissant avec une alimentation spéciale très élaborée. Le tout sous la surveillance de vétérinaires attentifs et d’entraîneurs techniques hyper compétents.
La réputation des Kabardines, malgré leurs performances médiocres, a perduré pendant plusieurs années. D’autres équipes sont venues du Caucase pour participer à des compétitions en France, bénéficiant de la même attention et de la même hospitalité. Partout je pouvais compter sur des bénévoles prêts à les accueillir et à les aider. La dernière équipe a ainsi pu s’installer, pendant trois semaines, dans le château Trélon de la Princesse de Mérode où les cavaliers ont pu préparer leurs montures tranquillement pour les compétitions de Compiègne. Diane de Mérode, qui était déjà devenue une amie à moi par cette passion commune, est venue encourager nos cavaliers et participer à la logistique pendant la compétition.

Malgré l’extraordinaire attention et l’aide que nous avons reçues partout, on s’est vite rendus à l’évidence que face à la technologie et à la science équines, la force naturelle des Kabardines ne faisait pas le poids. Ces chevaux rustiques étaient certes réputés pour leur endurance et leur capacité à évoluer en terrain accidenté, mais ils n’étaient pas très rapides ni particulièrement beaux. Même quand il s’agissait d’un marathon, on cherchait la vitesse et un peu aussi, pourquoi pas, la beauté de l’animal. C’est à ce moment-là que j’ai entendu de nouveau le nom du cheval karabakh. L’entraîneur de notre équipe, un ancien militaire qui avait déjà travaillé en Azerbaïdjan, connaissait bien cette race. Selon lui, les Karabakhs réunissaient toutes les qualités requises.
Moi-même j’étais retournée en Azerbaïdjan plusieurs fois après la guerre, soit pour écrire sur des questions géopolitiques, soit pour des films documentaire sur des sujets liés à la mer pour l’émission Thalassa de France 3. Entre les plate-formes offshore, le bras de fer des grandes puissances pour le tracé des oléoducs, les pêcheurs d’esturgeon ou les aléas de la navigation sur la Mer Caspienne, il n’y avait pas beaucoup de place pour les équidés et j’avais complètement oublié l’existence du cheval karabakh. D’ailleurs mon unique connaissance à son sujet venait de la description de cette jeune fille rencontrée dans le musée des tapis de Bakou. Tant d’années s’étaient écoulées depuis...
Après une petite recherche sur Internet, j’ai trouvé le site web d’un petit groupe d’éleveurs. Ils m’ont confirmé qu’il ne restait en effet que très peu de Karabakhs. Encore une race en voie d’extinction donc!. Les Kabardines étaient désormais hors de danger, puisqu’ils étaient déjà connus et leur réputation les protégeait, mais ce n’était pas le cas des Karabakhs. Personne n’avait entendu parler de cette race. Ils étaient totalement inconnus dans le paysage européen. Quand j’ai demandé à mes interlocuteurs azéris, par mail, si je pouvais aller les voir sur place, on m’a répondu que l’endroit se trouvait loin de Bakou et que la saison n’était pas très propice, qu’il y avait beaucoup de boue partout.

Entre-temps, la France avait commencé à s’enthousiasmer pour les Akhaltékés turkmènes. J’ai participé à une rencontre au Turkménistan où étaient réunies les associations d’Akhaltékés du monde entier, allant des Etats-Unis à la Chine. Et puis, je me suis rendue chez un éleveur de Daghestan, voisin de l’Azerbaïdjan, qui avaitune trentaine de spécimens de cette race, conservés comme des œuvres d’art dans un musée. L’engouement était vraiment universel, mais je ne voyais aucun cavalier courir avec un Akhalteké dans les compétitions d’endurance. Ces chevaux étaient bien trop précieux pour cela. Et ils ne traînaient pas une histoire dramatique derrière eux pour que je m’y intéresse davantage.
Il fallait donc absolument trouver les Karabakhs. Existaient-ils vraiment ou avaient-ils tous péri pendant la guerre avec l’Arménie? Maintenant que les choses s’étaient calmées et que l’Azerbaïdjan pouvait enfin s’occuper des problèmes moins pressants, je pouvais demander aux autorités officielles d’éclaircir un peu le sujet. Je suis donc allée frapper à la porte du conseiller culturel avec, sous le bras, les livres d’un écrivain-éditeur français, Jean-Louis Gouraud, reconnu dans le monde hippique comme une autorité en la matière. L’idée était de le faire inviter en Azerbaïdjan pour qu’il écrive sur le cheval Karabakh afin de le faire connaître au monde. Il nous avait déjà aidé dans notre aventure avec les Kabardines et mon récit sur le Karabakh l’intrigait tout autant. Il a fallu plusieurs visites et pas mal d’attente avant que j’obtienne une écoute intéressée. A tel point que nous avions presque cessé de croire à l’existence de ces chevaux mythiques, autant que mystérieux. On a finalement trouvé le bon interlocuteur en la personne de Monsieur Anar Karimov, fraîchement nommé ambassadeur à l’UNESCO. Et par une coincidence heureuse, il s’était déjà attelé à la tâche d’obtenir une reconnaissance pour les Karabakhs au sein de l’organisme international. Quitte à le faire par le biais d’un jeu azéri, le Chovgan. sorte de polo traditionnel pratiqué partout en Azerbaïdjan depuis des siècles.
Après pas mal de séances de débats houleux dûs à l’opposition des délégations indiennes et iraniennes, l’UNESCO a fini par inscrire le Chovgan dans sa liste du patrimoine immatériel de l’humanité, en précisant toutefois-détail important- qu’il était pratiqué sur des chevaux karabakhs!
La race pouvait enfin avoir une existence officielle sur le plan international. Il ne me restait plus qu’à aller les voir sur place pour dissiper mes derniers doutes.
Et c’était bien vrai. Le Karabakh existait bel et bien! Dans toute sa splendeur et sa beauté, avec cette robe unique scintillante, comme poudrée d’or. Non seulement le cheval existait, mais il y avait aussi tout un groupe d’hommes et de femmes passionnés et fiers de ce trésor de leur héritage culturel. A part les structures officielles bien organisées comme l’hippodrome de Bakou ou les haras du ministère des Frontières, des amateurs éclairés consacraient presque tout leur temps, leur argent et leur énergie à la sauvegarde et au développement des Karabakhs, dans des élevages dispersés à travers le pays. Car il venait de loin ce cheval et méritait toute l’attention. L’exfiltration des troupeaux de la zone de guerre, le Haut Karabakh, son berceau historique, avait été accompli sous les bombes arméniennes dans des conditions incroyables. Et la suite de leur épopée n’était pas moins dramatique.
Quant au livre, qui devait raconter toute cette histoire, Jean-Louis Gouraud a préféré m’en confier l’écriture, lui-même assumant la responsabilité d’éditeur. Les textes qui ont finalement résulté de mes voyages et de mes entretiens, sont donc autant l’histoire de ces chevaux d’exception que des humains rattachés à eux avec courage, abnégation et amour. La prochaine étape sera sans doute un film sur l’épopée des Karabakhs afin de les faire connaître au delà des murs de l’Unesco et du monde hippique. Le scénario est presque prêt!
Nur DOLAY (IRS)
Tags:






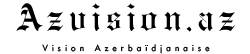










-3497350164.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)





























